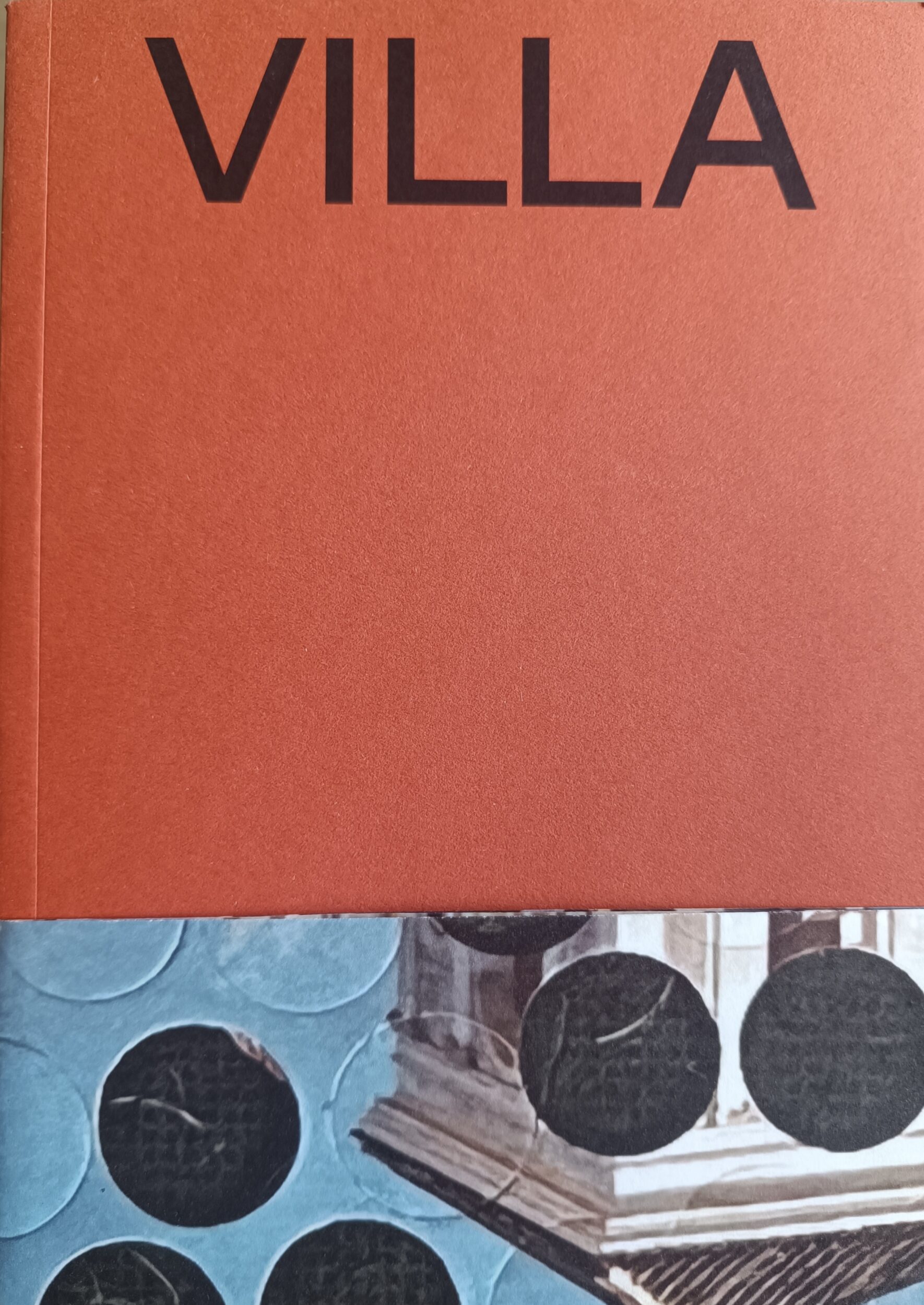Catalogue Villa Médicis 2023
2023Contribution au catalogue de présentation des artistes de la Villa Médicis de la promotion 2023 par l’intermédiaire d’un texte autour des travaux de l’artiste-plasticienne Anna Solal.
Tes mains saisissent, trient, disposent, avant de retrancher, de réserver puis de ressaisir les matériaux aux formes et aux textures plurielles. Puis tu obstrues ton œil droit avec le plat d’une de tes mains. Qu’il approfondisse ou infirme une perspective entraperçue plus tôt, ce geste participe au modelage de l’œuvre à venir. En t’observant, sur le seuil de l’atelier, je repense à plusieurs scènes d’Une infinie tendresse (1970), un film de Pierre Jallaud contant l’amitié de deux petits garçons handicapés au sein d’une institution spécialisée. Dans l’une d’entre elles, un des enfants, aveuglé par le soleil perçant par-delà la vitre de la fenêtre en face, place une main devant ses yeux. Ce geste de protection s’accompagne de minutieux déplacements des doigts. À travers la réorganisation des reflets de l’astre sur son visage en autant de motifs esthétiques, c’est soudain autre chose qui semble se jouer. Plus tard, différentes séquences renforcent ce sentiment. Nous y observons les deux garçons qui créent une œuvre à quatre mains. Comme toi, ils saisissent, trient, disposent, retranchent, réservent, ressaisissent différentes matières. L’agencement de ces éléments sur une grande feuille blanche forme les contours d’une fresque à la beauté primitive. Elle représente deux enfants qui évoluent parmi la nature. Des brindilles y figurent les arbres tandis que des formes découpées dans divers tissus forment les corps des protagonistes.
Quant au soleil et aux nuages, ils trouvent leur incarnation dans quelques bouts de ficelle. Toi aussi tu procèdes à cette mise à nue. Patiemment, tu désosses, tu extirpes, tu excaves. Les matériaux dont tu nourris ta pratique diffèrent de ceux utilisés par les deux garçons, par leur caractère plus abrasif. Il s’agit par exemple d’écrans de téléphones mobiles brisés, de tiges de fer, de morceaux de miroirs, de chaînes de vélos ou encore de semelles de chaussures. Au moment où tu les récoltes dans la rue ou dans des magasins, ils ne sont plus que des reliquats de l’époque, des rebuts délaissés par les objets qui les hébergeaient, eux-mêmes délaissés par leurs propriétaires, à rebours de la modernité qu’ils sont censés figurer. Sous tes mains, leur réunion édifie des formes nouvelles: celles d’un oiseau, d’un cerf-volant ou encore d’une marguerite. Ils y voisinent avec des techniques plus traditionnelles telles que des morceaux de papiers coloriés ou encrés mais aussi avec d’autres avatars. Ainsi des captures d’écran qui ornent les façades d’une arène dans ta pièce Arène (2022). Ce chevauchement des textures et des matières renvoyant à différentes temporalités fait écho à son tour à des dispositifs anciens, comme les palimpsestes, ces manuscrits médiévaux constitués d’un parchemin don’t on faisait disparaître les précédentes écritures afin de pouvoir y écrire de nouveau. Le regard explore les replis de ces inframondes, cherche une échappatoire vers les marges du cadre ou de la structure de l’installation. C’est au spectateur seul de naviguer entre les strates et d’en faire sa propre lecture.
Les titres de tes œuvres, simples traductions typographiques des objets ou situations représentés, invitent à ce décloisonnement, à cette conscientisation du fait que ce que l’on observe excède la description purement objective. Un souvenir, connexe à ce décentrage du regard, me revient. Il y a quelques mois, nous discutions dans la cuisine de notre appartement. L’œuvre photographique de David Wojnarowicz s’est lovée dans notre conversation sans que je me souvienne exactement des modalités de son surgissement. Nous repensons à sa photographie intitulée Untitled (Buffalo) (1988) où quatre bisons tombent d’un massif rocheux. Nous songeons d’abord à la chronophotographie d’Étienne-Jules Marey en raison du mouvement très séquentiel des animaux tandis que les paysages en arrière- fond évoquent davantage le travail du photographe-ethnologue Edward Sheriff Curtis qui entreprit, à l’orée du XXe siècle, d’établir un inventaire photographique des tribus indiennes. Quelle est la source de cette photographie? L’artiste américain aurait-il simplement photographié la page d’un ouvrage? Nous n’osons le croire. La réponse ne tarde pas: il s’agit du fragment d’un diorama d’histoire naturelle exposé dans un musée de Washington DC, sélectionné, cadré et photographié à la perfection. Ici, le regard coulisse d’une extinction à l’autre. De celle des animaux à celle des corps queer emportés par les ravages du sida. Celle du corps de l’artiste lui-même, qui décédera des suites de la maladie quatre ans après la réalisation de cette œuvre.
L’été dernier, j’ai pu observer la gestation de deux de tes dessins qui prennent également pour source le motif animalier. Dans le premier, un lapin est pris au piège d’un fil barbelé. Dans le second, un agneau nous regarde, son corps est mêlé à des éléments métalliques. Ce travail autour des animaux a pour point de départ un texte dont j’ai commencé la rédaction lors d’un séjour à Marseille. Sous la forme d’un conte initiatique, il fait le récit d’un âne métamorphosé en larme à la suite de son décès sous les coups des hommes. Mû par une quête dont je tairai les tenants et aboutissants, cet âne parcourt une Europe décharnée, sur laquelle pèse un climat de violence sourde. J’ai essayé de mettre en mots certains sujets qui me tiennent à cœur. La mémoire, les traumatismes liés à l’Histoire du XXe siècle, le symbolisme biblique, l’engagement militant. Certaines images. Certaines références décisives enfin. La beauté confondante des dialogues rabbiniques d’Edmond Jabès dans son Livre des questions (1963), l’infinie poésie des films-essais de Jean-Daniel Pollet, l’écriture paradoxale, car en même temps froide et affectée, d’Agnès Rouzier. Ainsi, un dialogue a pu être initié entre nos deux pratiques, plastique et écrite. J’en suis heureuse.